- William Makepeace Thackeray -

William Makepeace Thackeray (1811-1863- est l’un des plus importants romanciers britanniques de l’époque victorienne, contemporain de son rival Charles Dickens.
Né en Inde dans un faubourg de Calcutta le 18 juillet 1811, Thackeray a quatre ans quand meurt son père, qui travaillait pour la compagnie des Indes orientales. Sa mère l’envoie en 1817 seul en Angleterre. Elle l’y rejoindra avec son second mari l’année suivante. En 1830, après deux années d’études à Cambridge, Thackeray abandonne et voyage en Allemagne. À son retour, sans grande motivation, il reprend des études de droit. Menant la vie d’un jeune anglais aisé – à vingt et un ans, il est entré en possession de l’héritage de son père – il veut devenir peintre et s’installe à Paris pour étudier les Beaux-Arts. Au début de l’année 1833, son beau-père investit dans un journal dont Thackeray devient le correspondant parisien. Suite à la faillite du journal et à celle de la banque indienne dans laquelle la famille a placé son argent, il se retrouve ruiné. Il trouve néanmoins un nouveau poste de correspondant à Paris pour deux journaux anglais. En 1836, il épouse Isabelle Shawe, une jeune Irlandaise sans fortune dont il a trois filles.
De retour à Londres, Thackeray multiplie les contributions dans les journaux sous différents pseudonymes. C’est alors que meurt sa deuxième fille et que sa femme sombre dans la dépression puis dans une folie dont elle ne se relèvera jamais. Il s’occupe seul de ses deux enfants.
Après avoir publié sans succès quelques ouvrages, dont une première version des Mémoires de Barry Lyndon en 1844, Thackeray devient célèbre en publiant dans le magazine Punch en 1846 un feuilleton hebdomadaire, “The snobs of England by One of Themselves” (“Les snobs d’Angleterre par l’un d’entre eux”) puis triomphe en 1848 avec la parution de Vanity Fair (La foire aux vanités), roman dans lequel il décrit l’ascension d’une jeune institutrice prête à tout pour se hisser dans la société britannique.
Parallèlement à ces ouvrages, Thackeray, comme beaucoup de ses contemporains, publie sous le pseudonyme de Michael-Angelo Titmarsh des livres de Noël. Le premier, Le bal de Mrs Perkins, paraît quelques mois avant La foire aux vanités. Le romancier américain Mark Twain choisira, en 1852, son premier nom de plume, Perkins, en référence à l’héroïne de Thackeray.
Parmi ces livres de Noël, La rose et l’anneau a un statut particulier. C’est le cinquième et dernier livre de Noël de Thackeray, qui l’écrit à Rome, en 1854, le succès enfin venu, libéré de l’angoisse de ne pas être reconnu à sa juste valeur – il ne sera pas jugé sur un simple divertissement. Il vient de terminer et publier une forme d’autobiographie, L’histoire de Pendennis. Rome est une halte heureuse. Avec La rose et l’anneau, c’est le goût de Thackeray pour l’Histoire, son obsession du snobisme, son aspiration à une grande liberté de ton qui sont portés à leur acmé. Et si le texte emprunte tous les codes du conte de fées, c’est pour mieux les subvertir et parodier ses contemporains, dénoncer l’absurdité de ceux qui gouvernent. C’est d’ailleurs dans un événement sanglant que le livre prend sa source : la guerre de Crimée qui a débuté en 1853 et qui oppose la Russie, désireuse de s’emparer de l’empire ottoman, aux forces anglaises et françaises. On devine la Russie derrière la Crime-Tartarie, les Turcs derrière les Paphlagoniens.
Thackeray en commence l’écriture juste avant d’être saisi d’une fièvre maligne dont les effets le tourmenteront jusqu’à la fin de sa vie. Les années 1850 voient sa santé s’affaiblir. Il n’en publie pas moins pour autant romans et recueils parmi lesquels L’histoire de Henry Esmond, Les Newcome et Les Virginiens.
Il s’éteint le 24 décembre 1863, à 52 ans, victime d’une attaque d’apoplexie.
Immense romancier, satiriste, mais aussi illustrateur, Thackeray a laissé une trace indélébile dans la littérature anglaise. On lui doit l’invention du mot snob. Vanity fair, du nom de son roman, est devenu l’un des magazines les plus connus au monde. Le cinéaste Stanley Kubrick a adapté Les mémoires de Barry Lyndon en 1975.
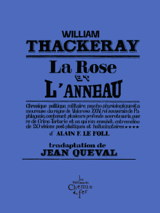
Haut de page
La rose et l’anneau
L’artiste : Alain Le Foll
Le traducteur : Jean Queval
Retour au catalogue
Acheter le livre
Adhérer à l'association